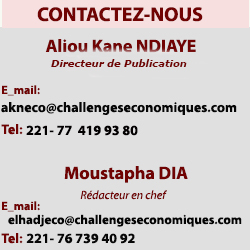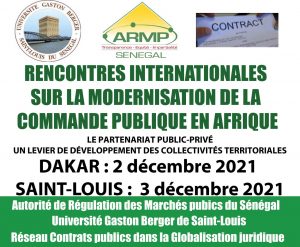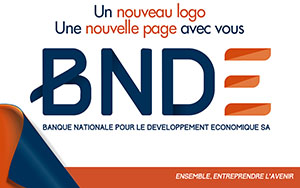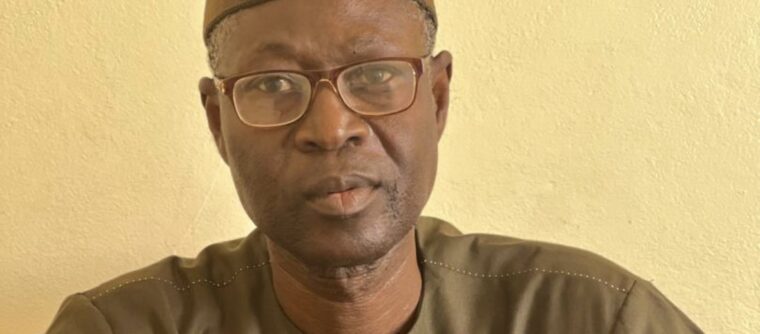
Par Pr Amath NDIAYE – Économiste, FASEG-UCAD
Alors que les finances publiques sénégalaises font face à des tensions croissantes, la question d’une restructuration ordonnée de la dette devient incontournable. Avec un encours estimé entre 118 % et 132 % du PIB, selon le périmètre retenu, et un besoin de financement brut de 5 715,5 milliards FCFA en 2025, le pays se trouve à un tournant décisif : continuer à emprunter dans des conditions prohibitives ou réaménager sa dette pour restaurer la confiance.
Un cercle vicieux du refinancement
Le Sénégal s’enlise dans une logique de refinancement permanent. Chaque nouvel emprunt contracté pour honorer les échéances antérieures accroît le stock de la dette, en raison des intérêts supplémentaires qu’il génère. Le service de la dette devient alors une charge récurrente qui prive l’État de marges budgétaires pour l’investissement.
En 2025, les intérêts représentent près de 16 % des recettes fiscales, soit un franc sur six perçu par le Trésor public. Cette situation est d’autant plus préoccupante que la croissance du PIB nominal, attendue à 7 % en 2026, reste inférieure au coût moyen de la dette (entre 7 et 8 % sur le marché régional), ce qui signifie que la dette croît plus vite que la richesse produite.
Des marchés saturés et des taux prohibitifs
Le marché UMOA-Titres, principale source de financement interne, montre aujourd’hui ses limites. Les banques sénégalaises, déjà fortement exposées, atteignent leurs seuils réglementaires. En parallèle, les marchés internationaux appliquent des taux supérieurs à 10 %, un niveau insoutenable pour un pays émergent.
Sur les 5 715 milliards FCFA de besoins prévus en 2025, moins de 3 000 milliards FCFA ont été levés à ce jour, en novembre. Le déficit de financement se creuse, faisant planer un risque de défaut partiel ou de retard de paiement si aucune décision forte n’est prise d’ici la fin de l’année.
Pourquoi la restructuration s’impose
Une restructuration préventive et concertée offrirait une issue plus soutenable que le statu quo. Elle permettrait :
- D’allonger les maturités et d’alléger le service immédiat. Le Ghana, en 2023-2024, a rééchelonné sa dette intérieure et extérieure sous supervision du FMI, tandis que la Côte d’Ivoire avait procédé dès 2011 à un allègement en collaboration avec le Club de Paris. À cette occasion, les créanciers avaient accepté de rééchelonner sur dix ans les remboursements et de différer les intérêts dus, après approbation d’un programme triennal du FMI au titre de la Facilité Élargie de Crédit. Cette approche graduelle a permis à la Côte d’Ivoire de retrouver rapidement la confiance des marchés et de relancer la croissance.
- De restaurer la crédibilité financière. Un accord adossé au FMI enverrait un signal fort aux partenaires techniques et financiers. Il faciliterait le retour des financements concessionnels et ouvrirait la voie à de nouveaux investissements directs étrangers (IDE), essentiels pour la réussite de la Stratégie Nationale de Développement (SND) 2025-2029.
- De protéger le système bancaire national. À l’image du Ghana, le Sénégal pourrait exclure la dette domestique de l’opération afin de préserver la stabilité du secteur financier.
Des exemples contrastés : Ghana vs Zambie
L’expérience ghanéenne montre qu’une restructuration anticipée et négociée peut redonner de l’oxygène budgétaire sans compromettre la crédibilité de l’État. Acculée en 2022, Accra a rééchelonné 5,4 milliards USD de dette, ramené le service à un niveau soutenable et relancé la croissance en 2024.
À l’inverse, la Zambie illustre les dangers d’une restructuration tardive. Premier pays africain à faire défaut pendant la pandémie (novembre 2020), elle a mis près de quatre ans à conclure un accord global, en raison de divergences entre créanciers (Chine, Club de Paris, détenteurs d’eurobonds) et d’un manque de transparence sur la dette des entreprises publiques.
Résultat : perte d’accès aux marchés, chute de la monnaie et affaiblissement durable de la confiance.
Le Sénégal doit impérativement éviter “l’effet Zambie” en agissant avant le défaut, dans un cadre maîtrisé, transparent et coordonné avec ses créanciers.
Les limites à anticiper
Certes, une restructuration n’est pas sans risques : négociations longues, réactions temporaires négatives des marchés, gel partiel de l’accès aux capitaux. Mais ces coûts demeurent inférieurs à ceux d’une crise de liquidité non maîtrisée. L’expérience récente des pays africains montre que la clé du succès réside dans trois conditions : la rapidité d’action, la transparence des chiffres et la cohérence avec un programme du FMI.
Éviter la rupture, rétablir la confiance
En 2025, le Sénégal doit faire face à un mur de dette sans précédent, dans un contexte de ralentissement de la croissance et d’épuisement des marges budgétaires. Continuer à emprunter à des taux prohibitifs reviendrait à prolonger une situation intenable. Une restructuration bien négociée, adossée au FMI, permettrait au contraire de reprofilier la dette, de relancer l’investissement public et de rétablir la confiance des marchés.
Refuser de l’envisager, c’est courir le risque d’un défaut désordonné dont le coût économique et social serait bien plus lourd que celui d’une restructuration encadrée. L’heure n’est plus à la temporisation, mais à la lucidité : restructurer aujourd’hui pour mieux croître demain.