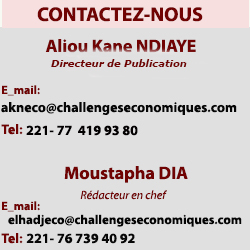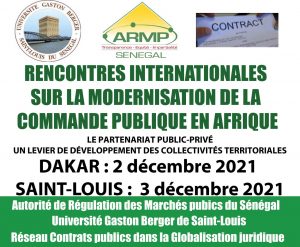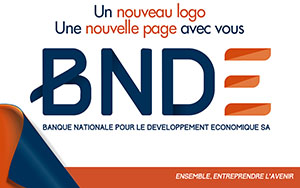Le FMI ajuste favorablement ses prévisions de croissance pour l’Afrique mais prévient de l’accumulation des risques, conseillant une meilleure mobilisation fiscale.
« Tenir bon. » Voilà, en deux mots, résumé le sentiment des économistes du FMI au sujet de l’Afrique. Une formule à double sens qui exprime bien le sentiment selon lequel la résilience du continent « a de quoi surprendre » mais que les facteurs de vulnérabilité demeurent. Le FMI prévoit une croissance de 4,1 % en 2025 puis un « léger regain » en 2026, « à la faveur de la stabilisation macroéconomique et des réformes en cours dans plusieurs des principales puissances économiques de la région ».
Toutefois, « cette résilience ne saurait être tenue pour acquise », prévient l’institution de Washington. « La plupart des pays de la région concentrent une multiplicité de facteurs de vulnérabilité, aussi bien sur les plans monétaire, financier, extérieur que budgétaire. L’incertitude perdure, et le solde des risques reste orienté à la baisse. »
Le FMI prévoit une croissance de 2,8 % dans la zone CEMAC (-0,2 point) et de 3,3 % en 2026. En UEMOA, la croissance ressort à 5,9 % en 2025 (-0,4 point) et à 5,6 % en 2026. À noter une croissance prévue à 4,8 % par an, en zone franc.
Dès lors, « la mobilisation des recettes intérieures et la gestion renforcée de la dette peuvent permettre de renforcer la stabilité macroéconomique tout en finançant les besoins essentiels de développement. »
Les prévisions sont en très légère hausse depuis le mois d’avril, ce qui traduit les avancées constantes en faveur de la stabilité macroéconomique et la poursuite des réformes, notamment en Éthiopie et au Nigeria.
Plus en détail, le FMI constate que le coût du capital intérieur reste élevé dans toute la région. Les marchés financiers intérieurs ne sont pas suffisamment développés : peu profonds et fragmentés, ils se caractérisent par un manque de liquidité, des coûts de transaction élevés et des écarts de taux d’intérêt notables. « Ces faiblesses structurelles renchérissent le financement des États et des entreprises, et limitent la capacité du marché à absorber les émissions de dette, en particulier s’agissant des instruments à long terme », s’inquiètent les économistes.
Ce problème est encore aggravé par l’instabilité monétaire et l’inflation, par l’opacité des secteurs financiers et le manque d’information quant à leur degré d’exposition à la dette, et par l’incertitude en matière de réglementation.
Dans beaucoup de pays, les nouveaux emprunts publics intérieurs sont nettement plus coûteux que les emprunts extérieurs. De plus, lorsque les États sont fortement tributaires du financement bancaire intérieur, le coût du capital sur le marché intérieur augmente encore davantage, ce qui décourage les investissements du secteur privé.
Des États trop dépendants des banques ?
Dans ce contexte, le recours croissant au financement intérieur est « porteur de nouveaux risques qui doivent faire l’objet d’une gestion prudente », juge le FMI. Il est vrai que les titres de dette souveraine au bilan des banques représentent des volumes considérables, qui augmentent plus vite en Afrique subsaharienne que dans le reste du monde.

L’interdépendance État –banques est susceptible de se transformer en cercle vicieux : la détérioration de la solvabilité des États entraîne « des effets délétères » sur la solidité du secteur bancaire ; si celle-ci est compromise, l’accès déjà limité au crédit privé risque de se restreindre encore davantage, au détriment de la croissance. Et le FMI de redouter d’éventuels sauvetages de banques, lesquels déclencheraient des sorties de capitaux et des pressions sur le marché des changes.
L’institution dégage deux priorités pour les pouvoirs publics : mobiliser les recettes intérieures et améliorer la gestion de la dette. Dans toute la région, des besoins urgents perdurent en matière de dépenses de développement, mais les financements extérieurs restent limités et le poids du service de la dette est élevé.
Pour alléger ces contraintes, les pays pourraient exercer une meilleure gestion de la dette afin d’élargir l’accès aux financements, de faire baisser les coûts de l’emprunt et de réduire le risque de surendettement.
Surtout, les pays mieux mobiliser leurs recettes intérieures, insiste une nouvelle fois le FMI. Cette politique peut permettre de reconstituer des marges de manœuvre budgétaires durables, tout en renforçant la stabilité macroéconomique et les moyens de l’État.
Obtenir des avancées significatives en matière de mobilisation des recettes intérieures s’est souvent révélé difficile, reconnaissent les économistes. Cela s’explique en partie par des contraintes structurelles, comme l’ampleur de l’économie informelle et le manque de moyens pour faire respecter la loi. « Néanmoins, les autorités peuvent exploiter un important « potentiel fiscal » inutilisé, à condition de s’attaquer de manière coordonnée aux obstacles administratifs, politiques et juridiques. » Les principales difficultés pour augmenter les recettes à partir de niveaux initialement faibles sont le manque de capacités techniques et, de manière générale, les problèmes de gouvernance, s’agissant notamment de la perception de la corruption. Pour conserver un niveau de recettes élevé dans la durée, il est nécessaire de renforcer la transparence et d’accroître la participation ainsi que la responsabilisation des différents acteurs. Et le FMI de suggérer « une double démarche » portant à la fois sur l’administration et la politique fiscale.

Le Magazine de l’Afrique